Studio
2
de l’Office national du
film
Dès
1949, on utilise à
l´Office national du film du
Canada (ONF) des magnétophones
pour alléger le matériel lors des
tournages. À
l´ONF, l´expérimentation
de la synchronisation entre la
caméra et le magnétophone dans
les années 1950 mènera au
cinéma direct un peu plus
tard. Les microphones sans fil
augmenteront l´autonomie. Une certaine
tradition
britannique, amenée
par le fondateur
John Grierson,
est présente dans les
premières années de l´ONF,
notamment dans les
secteurs techniques.
Le studio 2 de l´ONF
est construit en 1957 sur un
plancher flottant, pour une
insonorisation complète. Le secteur
français de l’ONF a
développé une
approche du son
davantage orientée
vers l´authenticité
plutôt que vers la
recherche d´effets.
Conception d´un studio
flottant à l´ONF (45´´) – Jackie Newell et
Jean-Pierre Joutel, enregistré en
2006
En
1967,
le projet Labyrinthes
du pavillon de l´Office national
du film, lors de l'exposition
universelle à Montréal, propose
des conceptions acoustiques
innovatrices. Une
certaine ambiophonie à l´origine du
procédé IMAX, avec une projection
sur des écrans atypiques, est
réalisée à partir d´un mixage
stéréophonique. Il était
encore courant de mixer en mono à
l´époque. L´enregistrement
multipiste est arrivé dès les
années 1950 dans le monde du
cinéma, à Montréal et ailleurs. On
utilise déjà 8 à 10 pistes en
1968.
Configuration
limitée
des consoles analogiques à
l´ONF à la fin des années
1960 (1´41´´) – Jean-Pierre
Joutel, enregistré en 2006
Technique de mixage du
temps des magnétophones à
ruban à l´ONF (1´03´´) – Jean-Pierre
Joutel, enregistré en 2006
Fragilité
de
la synchronisation avant l´ère
numérique et utilisation du
multipiste dans le monde du
cinéma avant les studios de
musique (1´35´´) – Jean-Pierre
Joutel, enregistré en 2006
En 1976, la
recherche de l'autonomie entre la
caméra et le magnétophone pour la
réalisation des films exigée par le
cinéma direct à l´Office national du
film du Canada a amené l'invention
d´un prototype du time code
par l´équipe technique de l'ONF. Ce
procédé de synchronisation du son à
l´image, fort utile dans les studios
de post-synchronisation, a été
utilisé pour le tournage du film
officiel des jeux olympiques de
Montréal.
Le studio 2
dispose actuellement d´une console
Solid State Logic (SSL)
entièrement automatisée de grande
valeur, permettant d´enregistrer
sur 200 pistes et de rappeler les
étapes précédentes à tout moment.
Des commandes permettent de mixer
n´importe quel son isolé et de le
spatialiser avec précision dans la
diffusion 5.1.
Nouvelle
console
SSL numérique à l´ONF (54´´) – Jean-Pierre
Joutel, enregistré en 2006
Console avec près de
200 pistes permettant de
rappeler des étapes
précédentes à l´ONF (1´27´´) – Jean-Pierre
Joutel, enregistré en 2006
Collaborateurs
:
À
la prise de son, Jos
Champagne est un pionnier
qui a inspiré plusieurs
professionnels du son, dont
Marcel Carrière, Esther
Auger, Serge Beauchemin,
Claude Beaugrand et Claude
Hazanavicius.
Au
mixage, Michel
Descombes,
ingénieur du son devenu
mixeur, a longtemps œuvré au
studio, ainsi que Louis
Hone. Descombes a été formé
chez RCA au
milieu des
années
1960. Il
deviendra un
des mixeurs de
film parmi les
plus respectés
à l´ONF, avec
Jean-Pierre
Joutel.
Des
musiciens
invités ou en
résidence à
l´ONF ont
beaucoup
expérimenté,
notamment
Alain Clavier
et Yves Daoust
de l´atelier
de création
sonore, et les
doyens Maurice
Blackburn,
Eldon Rathburn
et Normand
Roger.
Studio
6
Studio six avec un 16
pistes et renommée du technicien
Quentin Meek
(1´50´´) - Gilles Valiquette,
enregistré en 2006
Le studio
6 est un des
bons studios des années 1970. Il
dispose d´une console Neve. Dès
1970, ce lieu offre à sa clientèle
un magnétophone huit pistes.
Quelques bons techniciens ont fait
leur classe à cet endroit, dont Ian
Terry et Nelson Vipond. Fondé par
l´américain Chuck Grey, le studio a
élu domicile au 1180 rue
Saint-Antoine et au coin de McGill
College et Sainte-Catherine.
Proposant d´abord à la fin des
années 1960 un équipement peu
sophistiqué, le propriétaire a
investi pour acquérir une bonne
console et un magnétophone
16 pistes. C´était un
excellent technicien mais avec un
intérêt moins prononcé pour la
réalisation musicale. Il s´est
spécialisé en dessin technique
d´équipement de studio et travaille
maintenant pour le studio mobile de
Guy Charbonneau à Los Angles.
Quentin Meek, son partenaire,
possède des qualités de technicien
et de réalisateur. Les Séguin,
Gilles Valiquette, Jacques Michel,
Octobre et Harmonium profiteront de
son savoir-faire. Valiquette
notamment prend un soin particulier
à faire sonner ses enregistrements
avec la même énergie rock que les
productions anglo-saxonnes. Des
essais de compressions et de
relations des plans sonores sont
faits en studio pour simuler les
paramètres de diffusion de stations radiophoniques
rock tel que CHOM. L´album
n´est plus pensé en fonction d´une
compilation de succès, mais selon
des concepts sonores, artistiques et
graphiques qui font un tout. C´est
l´âge d´or du 33 tours.
Studio
12 de Radio-Canada (et anciens
studios)
 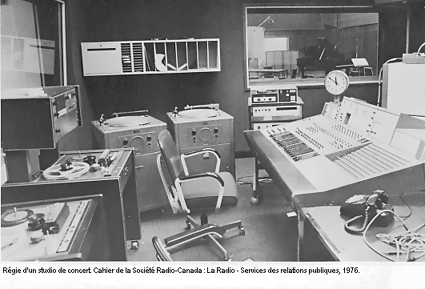
Studio et
régie de Radio-Canada, 1976
Modification des
studios à Radio-Canada et
intégration d´une acoustique
variable (1´15´´) – Alain Chénier,
enregistré en 2006
Depuis
les années 1960, le secteur
français de Radio-Canada développe
un service d´enregistrement sonore
avec des installations et des
équipements plus professionnels.
Avant ces années, les
enregistrements étaient faits
davantage dans un esprit de
reportage. Les premiers disques de
Radio-Canada International
sont enregistrés à Toronto.
Toutefois, Radio-Canada a beaucoup
appuyé les réalisations de Select.
Avant les années 1970, des studios
plus modestes ont été aménagés
pour la musique, mais davantage
dans un but de diffusion pour la
radio (sur
le boulevard René-Lévesque, près
de l´hôtel Sheraton) et la
télévision (à
la Cité du Havre). Le
réalisateur André Clerk a contribué
à former plusieurs preneurs de son à
Radio-Canada, dont Jean-Pierre
Loiselle. Une
expertise en enregistrement en
direct sur les lieux des
concerts et en studio s´est
développée.
Un des des pionniers de
l'enregistrement de la musique
classique au Québec est sans aucun
doute Gilles Poirier, qui a
travaillé à Radio-Canada et a
monté un catalogue inédit à partir
de 1978 (Société Nouvelle
d'Enregistrement). Il a enseigné
la prise de son au collège du
Vieux-Montréal dès la naissance
des cégeps vers 1968. Les
étudiants avaient accès aux
équipements et studios de
Radio-Canada à la Cité du Havre,
dont un magnétophone huit
pistes.
Le studio 12
original a été construit en 1973
en même temps que la tour de
Radio-Canada à l´est du
centre-ville de Montréal. En 1997,
le studio a été fermé pendant 18
mois pour des rénovations
majeures. Avant les rénovations du
studio 12, un autre studio, le
studio 13, a servi à
l´enregistrement de la musique
populaire qui requiert une
acoustique neutre. Ce grand studio
a bénéficié d´un investissement de
2.5 millions de dollars. Il est
doté d´une acoustique avec des
panneaux à positions variables
(modifiant la réverbération de
0.5 à 1.7 seconde) et de
murs irréguliers éliminant les
foyers de réflexions des hautes
fréquences. Le nouveau studio 12 a
gagné en polyvalence, permettant
d´enregistrer aussi bien un
soliste qu´un orchestre
symphonique. La console analogique
et partiellement numérique de ce
studio est une Amek 9098 dessinée
par Rupert Neve. Radio-Canada
dispose d´un choix impressionnant
de microphones acquis au fil des
ans, dont certains microphones à
ruban des années 1950
particulièrement rares.
Acoustique du
studio 12 de Radio-Canada
(1´00´´) – Jean-Pierre
Loiselle, enregistré en 2006
Description de la
console Amek à Radio-Canada (1´12´´) – Jean-Pierre
Loiselle, enregistré en 2006
Conservation
des micros à ruban à
Radio-Canada
(1´07´´) – Jean-Pierre
Loiselle, enregistré en 2006
Studio
270
  
Studio
270, 2006
Évolution du studio
270 (1´45´´) –Robert
Langlois, enregistré en 2006
Console analogique
conçue par un agent secret
utilisée à la BBC et au studio
270 (2´00´´) – Robert
Langlois, enregistré en 2006
Robert
Langlois fonde le studio 270 en
1986, dans un sous-sol à
Outremont. D´abord fréquenté par
des artistes de musique actuelle,
ce studio acquiert une réputation
enviable auprès des musiciens
privilégiant une démarche
expérimentale. Ce genre de studio
offre une alternative moins
coûteuse, laissant aux musiciens
le temps et l´occasion d´explorer.
Les techniciens doivent faire
preuve d´ingéniosité. Depuis
le déménagement du studio dans un
local plus spacieux sur le Plateau
Mont-Royal, ce créneau se
développe et attire les artisans
de la musique alternative
populaire et du jazz. L´acoustique
soignée, l´heureux mélange
d´équipement analogique et
numérique, et l´expérience de
Robert Langlois et de Bernard
Grenon confèrent une personnalité
particulière à ce
studio.
Combinaison
du
monde analogique et
numérique
(1´45´´) – Bernard
Grenon et Robert
Langlois, enregistré
en 2006
Studio
communautaire du collectif
Ondes de choc
et
Studio
du Sonographe
Entre
1975 et 1990, des
regroupements de musiciens tels que
Conventum, Ambiances magnétiques, le
Sonographe (branche du Vidéographe)
et Lunatic Asylum / Ondes de choc
ont uni leurs forces afin de
démocratiser l´accès aux studios et
d´enregistrer des musiques plus
spécialisées. Certains, tels Lunatic
Asylum et le Sonographe,
fonctionnent à la manière d'un
studio communautaire, enregistrant
des artistes émergents de la scène
alternative, dont Michel Faubert,
Marie Savard et Camel Clutch. Le
catalogue du Sonographe contient
des oeuvres de musique
traditionnelle, de contes, de
poésies, de chanson et de jazz.
Le réseau de distribution des
productions de ces studios étant
alternatif, le format cassette
est privilégié.
Ce
phénomène a vu le jour en
musique alternative et en
musique actuelle. La philosophie
du «Do It Yourself» a influencé
l'avènement de l'autoproduction,
de l'enregistrement à la mise en
marché.
À Montréal, cette
attitude de responsabilisation
du milieu de la musique
alternative a d'abord été
adoptée dans le milieu
anglophone, en 1976 environ,
puis cinq ans plus tard dans le
milieu francophone. Le matériel d'occasion
plus abordable, favorise
l´émergence de plusieurs studios
indépendants ainsi qu´une
bonne accessibilité des studios.
Cette attitude de
responsabilisation du milieu de
la musique alternative a été
adoptée à Montréal d'abord dans
le milieu anglophone en 1976
environ, puis 5 ans plus tard
dans le milieu francophone. Le
matériel d'occasion étant plus
abordable, cela favorise
l´émergence de plusieurs studios
indépendants à Montréal ainsi
qu´une bonne accessibilité des
studios.
Historique des
magnétophones multipistes
abordables pour les studios
indépendants (1´53´´) – Robert
Langlois, enregistré en 2006
Le fonds relatant
des activités de
production de l'atelier de
création sonore du Vidéographe,
appelé le Sonographe, est
conservé à la Phonothèque
québécoise. Jean-Jacques
Leduc, cinéaste
et membre fondateur du
Sonographe, a agi à titre de
preneur de son. Cet atelier,
qui fait figure de précurseur, a
été en
opération dans les années 1970
et 1980.
Studio
d´André
Perry à
Morin Heights et celui à
Montréal (Son Québec)
Début
fulgurant
d´André Perry et première
mondiale (1´20´´) – Ian Terry,
enregistré en 2006
Studio d´André Perry à
Brossard et description de sa
première console (2´12´´) – David P.
Leonard, enregistré en 2006
Historique des studios d´André
Perry
:
Au début
des années 1970, André
Perry, délaissant
son sous-sol de banlieue à
Brossard, inaugure
le studio Son
Québec (parfois appelé l´Église) dans une
église près du carré Amherst. En 1970, à
Brossard, il
dispose déjà d´un magnétophone 16
pistes, utilisé pour enregistrer le
groupe canadien The Bells. Il a
travaillé brièvement pour RCA en
début de carrière. Son approche est
plus systématique que celle de la
concurrence, privilégiant une
console de grande qualité. Lui-même
batteur de jazz, il comprend bien
les besoins des musiciens. Homme
d´affaires avisé, persuasif et
animé, brillant gestionnaire et
visionnaire, il a réussi à bâtir un
petit empire, grâce à la publicité
et à la notoriété que lui apporte
l´enregistrement qu´il fait avec
John Lennon, lors du bed-in avec
Yoko Ono en 1969 à Montréal. Selon
une entrevue accordée à la revue
Beatlology Magazine (par
Andrew Croft) en 2001, Perry raconte
qu´il a utilisé pour cette session
un simple magnétophone Ampex
quatre pistes loué chez RCA, avec
quatre microphones. Son propre
équipement était utilisé à la Place
des arts pour l´opéra rock Tommy. Un
magnétophone huit pistes a
toutefois été utilisé en
post-production.
Habitant
au-dessus de son studio, il voit à
tout. Omniprésent dans toutes les
étapes de production, il engage les
meilleurs techniciens, assurant un
contrôle serré de la qualité. L´aide
de
sa conjointe, Yael Brandeis, a
été déterminante. Il
a établi des normes de niveau
international, ce qui a inspiré les
grands studios montréalais, dont
Tempo, Piccolo, Marko, Victor et
plusieurs autres. En quelques années
d´opération, il a acquis des
équipements de studio qui non
seulement rivalisent avec ceux
utilisés chez la multinationale RCA,
mais devancent tous les
compétiteurs. C´est
le
premier studio au monde à disposer,
à partir de 1972, de deux
magnétophones 16 pistes synchronisés
à partir d´un contrôleur. Deux
pistes étant réservées à la
synchronisation, les musiciens
disposent ainsi de 30 pistes.
En
1970, la p arution
de l´album Jaune de
Jean-Pierre Ferland marque un
tournant dans l’histoire de la
chanson au Québec, par la qualité
des arrangements et de la production
artistique. Galvanisé par les
Beatles et Robert Charlebois, le
chansonnier s´entoure du musicien
Michel Robidoux et du réalisateur
André Perry pour concocter un
album-concept. Premier disque au
Québec à avoir été fait avec un
magnétophone 16 pistes, il a été
réalisé en huit ou neuf mois.
Auparavant, la réalisation d'un
disque au Québec s'effectuait en
quelques heures, ou au plus,
quelques jours.
Le studio de Perry sur
Amherst ne disposait pas d´une
acoustique aussi soignée que celle
du studio Tempo, ce qu´il corrigera
avec le studio
de Morin Heights, en 1974.
Ce perfectionniste décide de
s’installer en région rurale afin de
minimiser les coûts
d’insonorisation, préférant plutôt investir
dans l´équipement et dans la qualité
acoustique de la salle
d´enregistrement. Ce qui le motive
aussi, c´est d´offrir aux musiciens
un climat de travail agréable et
naturel. La première console est une
Trident. Ensuite, Perry acquiert une
console Solid State Logic (SSL) de
grande valeur, la première au Canada
et possiblement en Amérique du Nord.
L´Office national du film à Montréal
en possède une. Son service à la
clientèle, son sens des affaires, et
sa propension à prévenir les
problèmes techniques grâce à un
entretien méthodique des
équipements, lui permettent
d´attirer les plus grands noms de
la musique populaire anglo-saxonne.
Acquisition d´une
console SSL et vision de Perry
au moment de monter son studio
à Morin Heights
(1´39´´) – David P. Leonard,
enregistré en 2006
Normes de
qualité du service et de
maintenance chez Perry
(1´26´´) – David P. Leonard,
enregistré en 2006
Vers
1980, Perry acquiert l'une des
premières console de mixage
automatique avec 48 pistes, afin
de répondre aux exigences élevées
des clients tels David Bowie, Cat
Stevens, The Police… Daniel Lanois
suivra ses traces. Au milieu des
années 1980, le studio de Perry
devint aussi un complexe de
production vidéo et de
post-production de films, tendance
qui sera suivi par plusieurs
grands studios de Montréal.
En 1991, Marko acquiert
l´ancien studio d´André Perry à
Montréal (Son Québec) sur Amherst.
Collaborateurs :
Plusieurs
ingénieurs
du
son montréalais renommés ont
travaillé chez Perry.
Michel
Éthier
a été le premier québécois à
recevoir un Juno. Il a travaillé
chez RCA, chez Perry et chez
Tempo, développant une
réputation de rapidité et
d´efficacité. Michel Lachance
est un des premiers preneurs de
son engagé par André Perry dans
son premier studio. Il a aussi
travaillé chez Stereo Sound.
Doté d´une grande sensibilité
musicale, il est devenu chef
ingénieur pour le studio Tempo,
puis réalisateur. Il a concocté
pendant plus d´un an l´un des
albums les plus peaufinés de
l´histoire du disque au Québec,
l´Heptade d´Harmonium.
Ian Terry a été engagé par André
Perry pour transférer ses
équipements de Brossard à
l´Église. Par la suite, il a été
assistant de Michel Lachance au
même studio. Il s´est joint à
l´équipe de Tempo. Il a enregistré
et réalisé plusieurs albums de
musiciens d´ici. D´origine
britannique, Paul Northfield a
travaillé pour André Perry à
Brossard et à l´Église.
Nick
Blagona a travaillé à Morin
Heights, notamment pour The
Police.
Studio
de
Herbert Berliner
Voir Studios
de
RCA Victor
Le
père d´Herbert
Berliner,
Emile
(inventeur du
disque plat
notamment), s’installe
à Montréal en 1899, sur la rue de
l’Aqueduc (Lucien L’Allier).
L’usine dispose à ses débuts
d’un équipement minimal,
constitué de quelques presses de
disques. Cette entreprise
commercialise en 1900 les premiers
enregistrements sur disque
fabriqués au Canada, dont le
diamètre est de 18 cm (7 po). Les
activités de pressage et de
distribution étant florissantes,
l’usine de Montréal prend un essor
dès 1903, avec l’apparition de la
Victor Talking Machine.
En
1903, le premier studio
d’enregistrement ouvre ses
portes à Montréal sur la rue Peel,
sous l’initiative
d’Herbert Berliner, fils
d’Emile Berliner. L’aventure dure
un an. Les premiers artistes
enregistrés à Montréal sont
d’origine française : Henri Cartal
et Fertinel, de l’école du
vaudeville (répertoire grivois).
L. Loiseau et Joseph Saucier
furent parmi les premiers artistes
québécois à enregistrer des
disques, notamment La
Marseillaise, enregistrement
entièrement fait au Canada, en
1904. La plupart des artistes
canadiens enregistraient à
l’extérieur du pays, dont Emma
Albani et Henry Burr. Ces
interprètes se devaient d’être
polyvalents : folklore, opérette,
musique de salon, chant
patriotique, musique sacrée,
romances.
Devant les succès de la
petite entreprise de Berliner à
Montréal, une compagnie est
constituée en 1904 : la Berliner
Gramophone Company of Canada. Il s’agit en
fait d’une nouvelle charte de la
même compagnie. Herbert Berliner devint
un des actionnaires. La
Berliner Gramophone Company of
Canada achète en 1906 un terrain
au coin des rues Lenoir et
Saint-Antoine, dans le but de
construire une nouvelle usine.
Le rythme de
croissance est
impressionnant. En 1914, la
Berliner Gramophone Company of
Canada engage 150 employés à
Montréal. La compagnie domine
le marché canadien de
l’industrie du disque. Sa
production d’appareils et de
produits en 1917 augmentera de
217%, ne suffisant plus à la
demande.
Herbert
Berliner
crée en 1916 une série sur
l’étiquette His Master’s Voice.
Celle-ci est
consacrée aux artistes
canadien-français dont
Hector Pellerin, Paul Dufault, le
professeur Ladébauche, Henri
Prieur, André Descart, José
Delaquerrière, Arthur- Joseph
Boulay et Charles Dalberty. De la
musique instrumentale, classique
et populaire, est aussi
publiée : Henri Miro, Raoul
Duquette, Albert Chamberland,
Willie Eckstein, Harry Thomas et
l’ensemble de Montréal Venetian
Garden.
Herbert Berliner aurait même
enregistré George Gershwin, jeune
pianiste substitut appelé alors
Lew Gershwin.
Herbert
Berliner
fonde la Compo Company en
1918 à Lachine, afin
de presser les disques des
concurrents faisant affaire à
Montréal. Une première entente est
conclue avec Phonola (première
compagnie
de disques canadienne devenue
allemande). Puis, dès 1919, un
accord est signé avec Gennett de
la compagnie Starr Piano
Company. Plus
tard, les compagnies Banner,
Regal, Domino, Crown, Royal,
Sterling, Melotone, Lucky Strike,
Brunswick et Decca feront presser
leurs disques chez Compo.
L’enregistrement des matrices
était réalisé à l’étranger, mais
parfois à Montréal. Compo produit ses
propres disques Apex, Radia-Tone,
Sun, et à partir de 1923, des disques
de jazz pour le marché noir
américain de marque Ajax. Certains
disques 78 tours gravés à Montréal
comportaient environ 20% plus de
sillons, préfigurant de façon
modeste le disque à plus longue
durée.
Roméo
Beaudry,
directeur de la section
française de la Starr Company of
Canada, qui produit le plus
grand nombre de disques
québécois en 1924,
octroie à Herbert
Berliner, en
1919, le contrat de pressage de
toute la production de disques
Gennett à partir de matrices
faites aux États-Unis. En
1920, Beaudry
poursuit des activités de
producteur pour l´étiquette
Gennett sur
le boulevard Saint-Laurent à
Montréal. Il
enregistre au studio
d'enregistrement d'Herbert
Berliner plusieurs artistes dont
Hector Pellerin, Isidore Soucy,
Ovila Légaré, Alexandre
Desmarteaux et surtout Mary
Travers, connue sous le nom de
La Bolduc.
Dès
1921,
Herbert Berliner fait concurrence à
son frère Edgar. Il lui
ravit les meilleurs professionnels
et les engage chez Compo, dont Henri
Miro, directeur musical, Elmer
Avery, ingénieur du son et Walter B.
Rogers, compositeur et ingénieur du
son de la Victor. Cette
nouvelle équipe dispose d´un studio
d'enregistrement sur la
rue Metcalfe. C´est dans ce studio
que seront
enregistrés les
nouveaux disques Starr pour le
marché local.
Herbert Berliner baisse les
prix de ses disques Apex depuis
quelques temps, ce qui est un des
facteurs, mais pas le seul,
poussant son frère Edgar à vendre la
nouvelle usine Berliner et sa filiale His
Master’s Voice à la
compagnie Victor Talking Machine
en 1924; Edgar
Berliner en acquiert une part
importante et devient président. 50 %
des parts appartenaient déjà à la
Victor, ce qui laisse à penser qu'il
y a d'autres raisons à cette vente.
La même année, Herbert
Berliner
fonde la maison de disque Sun à
Toronto, appelée plus tard Apex.
L'instauration d'une industrie
canadienne du disque encourage la
réalisation de quelques
nouveaux
enregistrements à Montréal
et
à Toronto.
Avant
qu’Herbert Berliner ne fonde
Compo, la compagnie Victor n´apprécie guère
l’essor des disques canadiens, au
détriment de ceux pressés aux
États-Unis. Herbert
Berliner
s’associe avec la Starr et
d’autres petites compagnies pour
contrer l’attitude de monopole de
la Victor. Celle-ci perd ses
procès. Les revendeurs bénéficient
d’une liberté d’approvisionnement
et de fixation des prix.
Herbert Berliner et Roméo Beaudry
publient près de 100
enregistrements d’artistes
francophones en 1927, 10 fois plus
que son concurrent Victor-HMV.
Beaudry adapte en français des
succès américains, pratique qui
traversera le siècle.
Emile Berliner
meurt à Washington en 1929. Il était également
inventeur des tuiles acoustiques
pour amortir le son des salles et
des studios trop réverbérants.
John
Bradley, successivement preneur
de son au studio
Layton Brothers en 1948 et responsable
du
matriçage (mastering)
chez Compo à Lachine puis chez
London à Montréal, a travaillé
auparavant pour les fils de
Berliner dans les années 1930.
En
1951,
Herbert
Berliner
vend Compo à Decca. C´est la
fin d´une époque.
Studio
de
l´Institut Trebas
à Montréal
 
Studio
de l'Institut Trebas,
2006
David P. Leonard et Nelson Vipond,
ingénieur du son et professeur
Conception acoustique
des studios Saint-Charles et
Trebas (55´´) – David P.
Leonard, enregistré en 2006
David
P. Leonard, directeur de l´Institut
Trebas, a
connu diverses expériences dans le
milieu. Il a mis sur pied un petit
studio (Leonard studio) au début
des années 1960. Il a travaillé à New
York dans l´un des premiers
studios où l´enregistrement
multipiste est utilisé de façon
professionnelle. Il sera le premier à
importer cette technologie au
Canada.
En
1979, l´Institut Trebas
est fondé. Quelques collèges de
cette entreprise apparaissent au
Canada. Longtemps
installé au Vieux-Montréal, le
collège, maintenant sur la rue
Sherbrooke, dispose d´un
studio conçu par l´acousticien
Serge Melançon, qui a travaillé
au Lincoln Center et aussi conçu
le studio Saint-Charles. Le
studio est prioritairement
utilisé pour les activités
pédagogiques. Le
programme vise à former des
jeunes voulant acquérir
les outils pour oeuvrer
dans le milieu du son
(en musique, cinéma et
multimédia).
Nelson
Vipond,
qui a travaillé notamment au
Studio 6, y enseigne. Émile
Lépine, graveur, a aussi enseigné
ce métier chez Trebas.

Studio
de l´Université McGill
Dans les
années 1980, des collèges techniques
consacrés à l´enseignement des
métiers reliés à l´enregistrement
sonore, tels que Trebas et
MusiTechnic apparaissent à Montréal.
D´autres cégeps emboîteront le pas.
Le premier programme de maîtrise en
enregistrement sonore au Canada est
créé à l'Université McGill. La
compagnie réputée de microphone
Bruël & Koer (acquise par Danish
Pro Audio) a acheté un principe
développé à l'Université McGill. Il
s´agit de réflecteurs en forme de
balle mis au bout des microphones
qui, selon le diamètre, accentue une
bande de fréquences donnée. La
formation à cette université met
l´accent sur l´expérimentation, la
formation auditive (dont un cours de
solfège des timbres conçu par René
Quesnel) et les connaissances
techniques. Les studios des facultés
de musique ne servent pas qu´à
enregistrer les musiciens en jazz et
en musique classique. Certains
groupes de la musique alternative
montréalaise font des
enregistrements dans les périodes
non utilisées, ce qui permet à
l´équipe technique et aux musiciens
d´expérimenter à peu de frais le
travail en studio. Johanne Goyette,
responsable de la maison de musique
classique ATMA, a eu sa formation en
prise de son à l'Université McGill.
Brad Michael fut son mentor. La
prise de son acoustique demande
intuition, sens analytique, oreille
artistique, dosage entre le son
direct (intelligibilité) et le son
réverbérant (ambiance) et
concentration. Ce type de prise est
privilégie non seulement en musique
classique mais aussi parfois en
jazz, folk et chanson intimiste. Carl
Talbot, ingénieur du son pour
Analekta notamment, a aussi étudié à
l´Université McGill, de même que les
trois associés
du
studio Saint-Urbain, dont le doyen
André White qui y a enseigné.
Cours
de
solfège timbral et de
distinction des acoustiques à
l´Université McGill – (1´00´´) – Hendrick
Hassert et Paul Johnston, enregistré en 2006
Réflecteurs
vissés
à des microphones pour
équilibrer naturellement les
divers registres de
fréquences (1´04´´) – Jean-Pierre
Loiselle, enregistré en 2006
Studio
du collège MusiTechnic
 
Laboratoires
du collège MusiTechnic, 2006
Prémisses
à
la fondation du collège
Musitechnic (59´´)
- Gilles Valiquette, enregistré en
2006
Premier studio
avec une intégration
systématique de l´informatique
à Montréal (1´58´´)
- Gilles Valiquette, enregistré en
2006
Gilles
Valiquette
innove en concert et en studio,
en utilisant des technologies à
la fine pointe à l´époque. Ces
expériences amèneront Valiquette
à fonder le premier studio avec
une intégration systématique
de l´informatique au
Québec.
Quand l´industrie locale a
compris le potentiel de ces
nouveaux outils, Valiquette
a
troqué ses fonctions de
propriétaire de studio pour
celles de consultant en
informatique musicale, puis de
concepteur d´un programme de
formation dans le domaine,
embryon du collège MusiTechnic.
Ce collège est fondé en 1987.
Installé
sur le boulevard de Maisonneuve,
le collège dispose d´un studio
conçu pour le mixage en 5.1. Le
studio est prioritairement
utilisé pour les activités
pédagogiques. La clientèle des
débuts était surtout constituée
de professionnels et de
musiciens voulant se
perfectionner. Maintenant, la clientèle
se compose de jeunes voulant
acquérir les outils pour
oeuvrer dans le milieu du
son (en musique, cinéma et
multimédia).
Studio
Karisma
Le studio Karisma est fondé
vers 1989 par Stéphane Morency,
sonorisateur expérimenté
anciennement du studio Pélo, et par
Marcel Gouin, du studio installé au
Spectrum. Auparavant, ce studio fut
une salle de répétition. Les
rénovations se sont succédées. Comme
dans le cas de plusieurs studios
renommés, plusieurs tests sont faits
périodiquement pour améliorer les
constituantes de la chaîne
d´enregistrement : conductivité
des câbles, taux d´échantillonnage
et résolution de plus en plus élevé,
atteignant 384K en 24 bits,
amélioration de l´acoustique,
emplacement des micros dans la salle
d´enregistrement et des sources dans
la salle de matriçage (mastering).
Des nouveaux services émergent pour
contrer l´arrivée des studios
domestiques : une salle de matriçage
avec des équipements de pointe, est
ouverte aux musiciens, afin de
compléter et d´améliorer une session
amorcée ailleurs. Karisma
offre désormais quatre
studios à sa
clientèle.
Description des
équipements pour la nouvelle
salle de matriçage (mastering)
chez Karisma (49´´) – Stéphane
Morency, enregistré en 2006
Studio
La Majeure
Au
milieu des années 1980, le studio
d'André Perry devint aussi un
complexe de production vidéo et de
post-production de films, tendance
qui sera suivi par plusieurs
grands studios de Montréal. Le
Studio La Majeure au centre-ville
de Montréal, opéré par le preneur
de son Luc Fontaine, s´est
spécialisé dans ce créneau,
délaissant les productions
musicales
Studio
Layton
À la fin des années 1940, le studio
Layton Brothers, au 1170 de la rue
Sainte-Catherine Ouest, offre aux
musiciens l'alternative
moins
coûteuse
de graver les enregistrements
directement sur le disque.
L´ingénieur de ce studio, John
Bradley, devient responsable du
matriçage (mastering) chez
Compo à Lachine puis chez London à
Montréal. Il acquiert à New
York un
magnétophone Ampex, en même temps
que Jean-Marc Audet. Bradley avait
travaillé auparavant pour les fils
de Berliner dans les années 1930.
La
maison Layton existe encore. On y vend
du matériel audio.
Studio
Leonard
Historique du studio
Leonard et renouveau des
productions anglophones au
Québec
(1´15´´) – David P. Leonard,
enregistré en 2006
Au
début des années 1960, David
P. Leonard, directeur de
l´institut Trebas, ouvre un petit
studio (Leonard studio) avec un
magnétophone Ampex acheté à New
York, offrant une alternative
moins coûteuse aux musiciens, avec
un équipement moins professionnel
que celui des grands studios. Il a
aussi fondé l´étiquette Monticana,
tout en enregistrant parfois pour
London, RCA et Columbia, des
productions de moindre envergure
d´une facture plus risquée. Avec
l´exemple de la compagnie Sun, les
multinationales s´aperçoivent
qu´il est parfois rentable
d´enregistrer à l´extérieur de
leurs grands studios. David P.
Leonard travaille dans un des
premiers studios à New York où
l´enregistrement multipiste est
utilisé de façon professionnelle
(magnétophone de trois ou quatre
pistes). Il sera aussi le premier
à importer cette technologie au
Canada. Les
studios indépendants émergent pour
répondre à une approche plus
personnalisée et innovatrice.
Studio
Marko
Voir Studios
de
RCA
Victor
 
Studio
Marko, 2006
Jean-Marc
Audet,
ancien employé de CKAC, fonde en
1948 le studio Marko, au coin de
Sainte-Catherine et de la Montagne.
L´endroit peut accueillir
un
orchestre. Auparavant, Audet
opérait avec un studio mobile. Il
s´était procuré un des premiers
magnétophones à Montréal. Il s´est
spécialisé par la
suite dans les
enregistrements de publicité.
Méthode
d´enregistrement en direct des
publicités radiophoniques chez
Marko (54´´) – Martin Cazes,
enregistré en 2006
Marko est déménagé ensuite sur la
rue La Gauchetière en 1967, dans un
des premiers studios privés à
bénéficier d´un immeuble conçu spécifiquement pour
l´enregistrement (insonorisation
intégrale des bruits de l´extérieur
et bonne acoustique à l´intérieur).
RCA, devant répondre à des besoins
grandissants, avait antérieurement
construit ce studio selon ses normes
(les plans étaient reproduits un peu
partout dans le monde). Des conques
convexes, similaires à celles du
studio Victor, sont encore
présentes. Félix Leclerc a
enregistré chez
Marko un de
ses premiers disques, Le P´tit
train du Nord. Les
grands studios tels que Marko,
Stereo Sound et RCA possédent
des chambres d´écho naturelles
et des graveurs de disques onéreux.
Les
petits studios doivent accomplir
la post-production chez ces
grands joueurs ou chez Sound
Scription Service.
Au
milieu des années 1980, Marko
se lance dans la
production vidéo et la
post-production de films. Serge
Lacroix, chef ingénieur du son
au studio Marko, acquiert en 1986
environ le premier
système numérique
d´enregistrement fonctionnel à
Montréal, soit le système Opus
huit pistes qui se vendait
environ 250,000$ à l´époque.
Changement de vocation
de quelques grands studios à
Montréal (1´41´´) – Martin Cazes,
enregistré en 2006
Acquisition du système
numérique Opus chez Marko (34´´) – Martin Cazes,
enregistré en 2006
En
1991, Hans Peter
Strobl, mixeur et ingénieur du son
au studio Marko, a intégré un
nouveau système de montage sonore
et de post-production pour le
cinéma pour remplacer l´ancien
système analogique et le travail
sur ruban. Le montage sur vidéo et
le système numérique appliqué
intégralement plus tard ont
grandement amélioré les services
en terme de rapidité et de
flexibilité. Pour offrir ces
nouveaux services, Marko a acquis
l´ancien studio d´André Perry à
Montréal (Son Québec) sur Amherst.
Studio
Piccolo, années 2000
Historique des
équipements au studio Piccolo
(1´04´´) – Dominique Messier,
enregistré en 2006
Le
studio Piccolo est créé en 1975.
Comme plusieurs indépendants,
l´entreprise commence avec un
magnétophone quatre pistes, puis
acquiert des équipements de plus en
plus professionnels.
L´enregistrement 24 pistes est
répandu dans les grands studios. Il
en coûte entre 45,000$ et 70,000$ à
l´époque pour acquérir ce
magnétophone qui deviendra
accessible aux petits studios plus
tard. De nouvelles compagnies
offrent des consoles et
magnétophones à prix plus
accessibles, permettant l´émergence
de studios indépendants.
L´investissement est encore élevé,
soit quelques centaines de milliers
de dollars. Le tarif demandé aux
musiciens est évalué en conséquence,
oscillant entre 100 et 250$ de
l´heure. Les meilleurs studios se
développeront pour enfin se
convertir à la technologie numérique
et atteindre parfois des offres de
services de niveau international.
 
Studio
Piccolo, années 2000
Les
plus grands studios offrent de
grandes salles avec une acoustique
de grande qualité. Piccolo
fait partie de cette catégorie, avec
ses cinq studios, en plus des
services de studio mobile.
Studio
Saint-Charles
Conception acoustique
des studios Saint-Charles et
Trebas (55´´) – David P.
Leonard, enregistré en 2006
Dans les
années 1970, les studios
indépendants émergent, devenant de
plus en plus professionnels et
compétitifs. L´acousticien Serge
Melançon, qui a travaillé au Lincoln
Center, a conçu le studio
Saint-Charles, en banlieue de
Montréal (Longueuil). Ce studio
fondé par le preneur de son Pierre
Tessier, jouit d´un bon équipement
et d´une bonne acoustique naturelle.
Plusieurs enregistrements de l´âge
d´or de la chanson québécoise ont
été enregistrés à ce grand studio
qui peut accueillir plus de 40
musiciens. Plusieurs
expérimentations ont également été
menées à cet endroit. Pierre
Tessier a œuvré auparavant chez Stereo
Sound.
Studio
Saint-Urbain
Type de prise de son
selon le contexte et
appréciation de l´ambiance
acoutique naturelle (1´12´´) – Hendrick
Hassert, enregistré en 2006
Transformation du
rôle de la console et
prédominance du rôle de
l´ordinateur et des
convertisseurs –
(1´10´´) – Hendrick Hassert,
enregistré en 2006
Avec
l´arrivée des studios de
réalisateurs, sans espace consacré
à l´enregistrement sonore, et des
studios domestiques de musiciens,
suite à la démocratisation des
équipements, les studios
s´adaptent. Ils offrent des
espaces avec une acoustique de
bonne qualité, des services de
postproduction et de matriçage
(mastering), et des
techniciens qualifiés. Le studio
Saint-Urbain, ouvert en 2004, suit
cette logique. Il compte sur la
formation à l´Université McGill de
ses trois associés, dont le doyen
André White, qui y a enseigné, et
sur leurs sensibilités de
musiciens à l´écoute des besoins
des clients. White est un batteur
de jazz qui a joué avec Sonny
Greenwich. Le rôle du preneur de
son en musique spécialisée change
radicalement avec l´émergence des
productions indépendantes gérées
par les musiciens eux-mêmes :
le technicien suggère et conseille
plutôt que d´imposer. Ce
studio vise une clientèle de
musiciens cherchant une acoustique
et des conseillers de premier
ordre.
Ambiance
de
travail et équipement au
studio Stereo Sound
(45´´) - Gilles Valiquette,
enregistré en 2006
Dans
les années 1960, le studio Stereo Sound,
situé dans le
quartier
Côte-des-Neiges au
pied de la montagne,
est une des rares
alternatives
valables à la
multinationale RCA.
À l´instar de
RCA, ce grand studio possède aussi
des chambres d´écho. Il y règne
une ambiance stimulante qui fait
cruellement défaut au studio RCA.
En 1967, ce
studio est équipé d´un
magnétophone quatre pistes.
L´ingénieur du son Gatien Roy a
fait beaucoup d´enregistrements
d´artistes populaires dans ces
années. Pierre
Tessier a œuvré chez Stereo
Sound, pour fonder par la
suite le studio Saint-Charles.
Michel
Lachance
a aussi travaillé chez
Stereo Sound. Il est devenu
chef ingénieur pour le
studio Tempo, puis
réalisateur (notamment de
l´album l´Heptade
d´Harmonium).
Paul-Émile
Mongeau, anciennement du
studio Stereo Sound,
sera en charge de la
gravure et du matriçage
(mastering) chez London
en 1955.
Studio
Tempo
Détermination
de nouveaux standards de
qualité à Montréal avec le
studio Tempo et celui de
Perry (1´02´´)
– Ian Terry, enregistré en
2006
Traitement
acoustique d´avant-garde
au studio Tempo selon les
plans du studio Record
Plant à NY
(1´16´´) – Ian Terry,
enregistré en 2006
Historique
du studio :
Ce
studio ouvre ses portes en
1972 sur
McGill College, au centre-ville.
Fermé depuis quelques années,
c´est un des rares studios
montréalais à opérer pendant 30
ans. Au début, trois magnétophones
sont fonctionnels : un 4
pistes, un 8 pistes et un 16
pistes. Copie exacte du studio
Record Plant à New York, les plans
ont été achetés de Tom Headly,
concepteur et acousticien pour les
studios Westlake.
Studio Tempo selon
les normes de la compagnies
Wetslake (59´´) -
Gilles Valiquette, enregistré en
2006
Ce nouvel établissement jouit
d´une acoustique bien pensée et
d´équipements normalisés (console
préfabriquée) qui ont fait leurs
preuves ailleurs dans le monde. Ce
qui est perdu en originalité, y
est gagné en fiabilité et en
flexibilité, un projet pouvant
être enregistré à plusieurs
endroits ayant le même design
sonore. Tom Headly a aussi conçu
le studio CINAR sur la rue
Saint-André à Montréal, près de
Sainte-Catherine. Ce modèle de
studio avec son acoustique
appréciée en musique populaire, à
l´avant-garde pour l´époque, a été
adopté par les trois fondateurs,
François Cousineau, Bernard Scott
et Yves Lapierre. Le studio
d'André Perry sur Amherst ne
disposait pas d´une acoustique
aussi soignée, ce qu´il corrigera
à Morin Heights. Tous ces
musiciens ont amené avec eux une
clientèle dès le début des
opérations. Michel Éthier, Michel
Lachance, et Ian Terry, les trois
premiers chef ingénieurs du son,
s´ajoutent à l´équipe. Le studio
Tempo acquiert un 24 pistes assez
tôt dans son histoire.
En
1976, devant des
rumeurs d´expropriation, le studio
Tempo déménage à Pointe
Saint-Charles, dans un ancien
cinéma. La console Neve est
remplacée par une console
britannique faite sur mesure. Ian
Terry devient ingénieur du son en
chef et
participe à la configuration du
studio et de la console. Le studio
Tempo a ensuite été acheté par
Modulations pour la
postproduction sonore en
audiovisuel.
Collaborateurs
:
Michel
Éthier a travaillé chez RCA,
chez André Perry et chez Tempo,
développant une réputation de
rapidité et d´efficacité. Il a
été le premier québécois à
recevoir un Juno.
Michel Lachance est
devenu
chef ingénieur pour le studio
Tempo, puis réalisateur. Il est
un des premiers preneurs de son
engagé par André Perry dans son
premier studio. Il a
aussi travaillé chez Stereo Sound.
Doté d´une grande sensibilité
musicale, il a concocté pendant
plus d´un an l´un des albums les
plus peaufinés de l´histoire du
disque au Québec, l´Heptade
d´Harmonium. Ian
Terry,
d´abord engagé par André Perry, a
été assistant de Michel Lachance
chez Tempo, un an après l´ouverture
de ce studio. Il est devenu
responsable technique en 1976. Ian
Terry a enregistré et réalisé
plusieurs albums de musiciens d´ici.
Entre 1985 et 2000, il s´est
consacré au jazz, enregistrant 135
disques pour l´étiquette Justin
Time, aux studios Tempo, Victor,
ainsi qu´aux États-Unis. Plusieurs
techniciens ont débuté comme
assistants chez Tempo, dont Billy
Szawlowski et Pierre Pagé, devenu
un preneur de son renommé et un
réalisateur de plusieurs albums de
vedettes au Québec. Billy
Szawlowski, excellent guitariste,
a succédé à Ian Terry comme
réalisateur d´April Wine et de
Mahoganny Rush.
Voir Studios
de
RCA
Victor
Le plus vieux studio encore en
opération à Montréal a été
construit par RCA en 1943, à
Saint-Henri, dans un local
adjacent à l’usine. Ce vaste
studio à la fine pointe de la
technologie de l’époque est doté
d’une excellente acoustique, grâce
à des panneaux en bois ondulés. Il
s’agit de l’actuel studio Victor
qui abrite aussi le Musée des
ondes Berliner consacré aux
appareils de reproduction et
d’enregistrement sonore. Ce studio
a été détourné de sa fonction
première de 1958 à 1985, servant
alors de lieu pour la conception
d´un satellite, puis d´entrepôt
chez RCA.
Abandon de
l´ancien studio RCA
transformé en entrepôt
avant la revitalisation
par le studio Victor
(53´´) – Michel Descombes,
enregistré en 1993
Avant de se lancer dans la
revitalisation de ce studio en
1985, les frères Pilon ont fondé
au début des années 1980 le studio
Son Soleil à Saint-Henri, dans un
sous-sol. Le nouveau studio Victor
a acquis une réputation enviable
ici et à l´étranger, notamment
dans les enregistrements qui
exigent une acoustique de qualité
optimale. L´entreprise possède
deux studios et une salle de
matriçage (mastering).
Voir Studio
de
Herbert
Berliner
Voir Studio
Victor
Voir Studio
Marko
Construction par RCA de
quelques studios partout dans le
monde avec le même plan que
celui acquis par Marko
(1´15´´) – Martin Cazes, enregistré
en 2006
Depuis
1903, la multinationale RCA
Victor a offert toute la
gamme de services permettant
de mettre en marché les
enregistrements sonores.
Plusieurs compagnies ont
occupé les locaux de l´usine
Berliner. Victor
Talking Machine Company
achète la Berliner
Gramophone Company of
Canada et sa filiale His
Master’s Voice en 1924. Victor
avait l’œil sur l’usine de
Montréal, concurrente de
l’usine de Camden au New
Jersey. Avant qu’Herbert
Berliner ne fonde Compo (voir Studio
de
Herbert
Berliner), la
compagnie Victor
n´apprécie guère l’essor
des disques canadiens, au
détriment de ceux pressés
aux États-Unis. Victor publie
commercialement le
premier enregistrement
électrique en
1925. En 1929,
la
compagnie
Radio
Corporation of
America (RCA)
acquiert à
Montréal la
Victor Talking
Machine
Company et
devient la RCA
– Victor.
En
1943, un vaste
studio à la fine pointe de la
technologie de l’époque est
construit par RCA Victor à
Saint-Henri, dans un local adjacent
à l’usine (voir Studio
Victor).
En 1949,
RCA Victor lance le 45
tours, dont ses séries en vinyle
rouge, jaune ou vert. D’abord
conçu pour concurrencer le 33
tours, RCA adopte ce format pour
la musique classique, et destine
le 45 tours aux succès
populaires. Dans
les années 1950, la demande
commence à se diversifier
avec le boom économique de
l’après-guerre et
l’affirmation d’une
génération qui s’imprègne à
fond de la société de
consommation. Lors
de
cette décade, RCA Victor ouvrira
un autre studio, à proximité de
l´actuel station de métro
Guy-Concordia, consacré à
l´enregistrement de la musique
populaire et à la publicité.
Description
du
studio RCA sur la rue Guy en
1965 environ (1´14´´) – Michel
Descombes, enregistré en 1993
L´essor
de l´entreprise à Montréal se
poursuit, obligeant en
1967 la
compagnie à construire un autre
studio à la fine pointe des
développements acoustiques et
techniques (voir Studio
Marko), sur la
rue La Gauchetière. RCA
acquiert un magnétophone Ampex 350
trois pistes. RCA continue d´être
la pierre angulaire de l´industrie
du disque, offrant des services de
gravure, de matriçage
(mastering) et de pressage,
contrairement aux autres studios
concurrents. À
partir de la fin des années 1950,
les studios indépendants profitent
de la concurrence entre RCA et
London pour la gravure et le
matriçage (mastering) des
disques (voir Salles
de
matriçage
(mastering) RCA, London,
SNB et RSB).
Service de gravure des
disques offert par RCA aux
studios montréalais (1´16´´) – David P.
Leonard, enregistré en 2006
Studio RCA sur La
Gauchetière avec un 8 pistes
(32´´) - Gilles Valiquette,
enregistré en 2006
Nouveau
magnétophone 24 pistes au
studio RCA sur la rue La
Gauchetière (23´´) – Bernard
Tremblay, enregistré en 1993
Michel
Descombes
travaille pour la compagnie RCA
de Montréal de 1964 à 1967. Il
commence à faire du matriçage
(mastering) au studio
situé sur la rue Guy de
Montréal, puis devient
assistant-technicien de studio
où il prépare les sessions
d'enregistrement. Dès 1965, il
travaille, avec son collègue
Bernard Tremblay, à la prise de
son et au mixage de nombreux
artistes de la période yé-yé
(Pierre Lalonde, Joël Denis, les
Classels, les Baronets, Tony
Roman). En 1965, on travaille
encore en monophonie, sans
technique multipiste et système
de réduction de bruit. On se
sert d'égalisateurs, de
compresseurs et de chambres
d'écho pour accentuer ou créer
de l'effet sonore. Les
transformations technologiques
majeures proviennent de Toronto
et surtout de New York. Durant
ces années, le
studio RCA de Montréal faisait
alors figure de parent pauvre,
héritant de la technologie déjà
utilisée auparavant.
Préparation typique
d´une séance d´enregistrement
au studio RCA au milieu des
années 1960 (1´40´´) - Bernard
Tremblay, enregistré en 1993
Chambre d´écho chez
RCA en 1965 (28´´) – Michel
Descombes, enregistré en 1993
Avec l´exemple de la compagnie Sun
et la découverte d´Elvis Presley,
les multinationales s´aperçoivent
qu´il est parfois rentable
d´enregistrer à l´extérieur de
leurs grands studios. Les studios
indépendants émergent alors pour
répondre à une approche plus
personnalisée et innovatrice.
Dans les années 1960, Harry
Bragg dirige le studio RCA, très
performant techniquement parlant
mais avec une atmosphère un peu
froide. Le studio dispose d´un
magnétophone huit pistes.
Attrait des studios
indépendants à cause de la
sclérose des grands studios
tel RCA (1´31´´) – David P.
Leonard, enregistré en 2006
Salles
de matriçage (mastering)
RCA, London, SNB et RSB
Très
tôt à Montréal, on dispose de lieu
de fabrication des disques et de salles
de matriçage (mastering). RCA
Victor tient le haut du pavé
jusqu´aux années 1950. Vers
1948,
le studio Layton Brothers, au 1170
de la rue Sainte-Catherine Ouest,
offre aux
musiciens l´alternative
moins
coûteuse de graver directement sur
le disque. Le résultat n´est
toutefois pas aussi professionnel.
L´ingénieur de ce studio, John
Bradley, devient responsable du
matriçage (mastering) chez
Compo à Lachine puis chez London à
Montréal. Bradley avait travaillé
auparavant pour les fils de
Berliner dans les années 1930.
Dans
les années 1950, la demande
commence à se
diversifier avec le boom
économique de
l’après-guerre. Entre 1950 et
1960, 18 nouvelles
étiquettes se disputent le
marché québécois. RCA continue
d´être la pierre
angulaire de l´industrie
du disque, offrant des
services de gravure, de
matriçage (mastering)
et de pressage,
contrairement aux autres
studios concurrents.
Lionel
Parent
fut un des graveurs renommés
chez RCA. Selon
Jean-Paul
Séguin, ouvrier et
syndicaliste à l'usine RCA
Victor à Montréal, le
département des disques
fonctionne jour et nuit dans
les années 1950. Il y a de
25 à 30 presses. 1000 à 1200
disques par jour sont
produits pour chaque presse
assignée à une personne. On
travaille à la pièce et non
à l'heure, ce qui rend
l´emploi très exigeant et
dur, car il fait très chaud
l'été (on donne des pilules
de sel pour la perte en
transpiration). On
procède par lot, qui varie de 50
à plusieurs milliers de disques.
Il peut y avoir de sept à huit
changements de matrices par
jour.
En 1955, la maison London
s´établit à Montréal (nom
américain de la maison
britannique Decca), d´abord à
titre de distributeur sur la rue
Sainte-Catherine de produits
étrangers et locaux. London
traite avec les compagnies
Philips-France, DSP, Jupiter et
Select notamment. En 1959,
devant la vitalité de
l´industrie de l´enregistrement
sonore à Montréal, London
installe une usine de pressage
et de matriçage (mastering)
qui fait concurrence à RCA.
Paul-Émile Mongeau, anciennement
du studio Stereo Sound, est en
charge de la gravure et du
matriçage (mastering).
Émile Lépine lui succédera de
1965 à 1982. Plus tard, Il enseignera ce métier
chez Trebas. Les systèmes de
gravure (tours à disques,
amplificateurs, burins,
consoles) utilisés à Montréal
sont construits à l´étranger par
les compagnies Neumann, Decca,
Neve, RCA, Scully et Westrex.
En 1965, on gravait en
mono pour les 45 tours, et parfois
en stéréo pour les 33 tours. Au
Québec, la tendance dans la
réalisation de disques est
d´imiter les productions
américaines. Par manque de
connaissances et d´outils, on
laisse passer des sibilances et
des petites distorsions dans les
hautes fréquences ainsi que des
effets de basses fréquences qui
sont difficiles à graver. Pendant la décennie
suivante, la situation se redresse
rapidement. La qualité des
techniciens et des équipements n´a
alors souvent rien à envier aux
productions étrangère.
Michel
Descombes commence
à faire du matriçage
(mastering) au studio situé
sur la rue Guy de Montréal pour la
compagnie RCA. Il deviendra un des
mixeurs de film parmi les plus
respectés à l´ONF, avec Jean-Pierre
Joutel. Il décrit la technologie
du matriçage (mastering ) comme un
«gramophone à l'envers». C'est-à-dire qu'on
envoie le son dans le disque par
un burin qui vibre dans le sillon
en
fonction de l'amplitude. Le travail
de graveur demande à être très
vigilant lors des variations
brusques de fréquences. Il faut un
produit parfait, car
Émile Lépine, graveur et
technicien responsable
du matriçage
(mastering) chez
London, chez SNB et
chez RSB à Montréal, commente en
profondeur les diverses
étapes de la gravure des
disques (voir Procédés
de
gravure des disques).
Dans
les années 1980, SNB
devient peu à peu une des compagnies
de matriçage (mastering) les
plus importantes,
parmi les trois meilleures en
Amérique du Nord. Les derniers
appareils de gravure de disques
vinyle sont nettement plus
automatisés qu´avant. L´avènement du
disque audionumérique transforme le
métier de graveur. La gravure
disparaît peu à peu. Le mastering
devient de plus en plus
sophistiqué. D´abord conçu pour
réduire le bruit de fond, le mastering
ajoute maintenant un vernis au
mixage final. Il permet des
ajustements globaux pour assurer la
cohérence de niveaux, de
l´égalisation et des autres
paramètres à l´ensemble du disque.
Renée Marcaurelle a acquis une
solide réputation dans le domaine.
SNB possède un espace
acoustique consacré au mastering
et un équipement de transfert
numérique à la fine pointe de la
technologie actuelle. L´usine
de pressage des disques
audionumériques n´altère plus le son
obtenu après le mastering,
contrairement à la période
analogique.
Dans
les années 1990,
avec l´avènement de la
technologie numérique, plusieurs
studios de réalisateurs voient le
jour, sans espace dédié à
l´enregistrement sonore. Suite
à
la démocratisation des
équipements, les musiciens aussi
acquièrent des studios
domestiques. Les studios semblent de
plus en plus lorgner vers les
services de matriçage
(mastering), offrant aux
musiciens
des équipements de pointe afin
de compléter et d´améliorer
une session amorcée à la
maison. Les
studios Karisma et Victor
notamment se sont notamment lancés
dans cette aventure.

Salle de
gravure chez London (amplificateur
Neumann
VG74),
1982
|
*
Photographies des
collections de la
Phonothèque québécoise,
de
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec,
des archives des studios
et des archives
personnelles des invités





Studios de
l'ONF, 2006




Studio 12 de
Radio-Canada,
2006

Ancien
magnétophone 24 pistes du studio 270,
2006

Studio 270,
2006
Compilation
de
groupes auto-produits
Studio près du
carré Amherst , 1972
Studio à Morin
Heights lors de la vente,
2003 circa
Studio à Morin
Heights
André Perry et
Nick Blagona au studio à Morin
Heights
Nick Blagona
au studio à Morin Heights
Premier
système numérique au studio à Morin
Heights
Archives de Nick
Blagona
Studio à Morin
Heights lors de la vente,
2003 circa
Premier local
de Berliner à Montréal acceuillant
quatre presses
Usine de
Berliner à Montréal
Usine de RCA
Victor à Montréal
Herbert
Berliner à l'usine Compo près de
Montréal

David
P. Leonard, directeur de l´Institut
Trebas
Studio
de l'Institut Trebas, 2006



Studio
du collège MusiTechnic, 2006
Studio
Karisma, 2006
Harrison
Pond dans son studio, 1938
Collections
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ),
Fonds Conrad Poirier
Studio
Leonard, 1963
Archives personnelles de David
P. Leonard
Studio
Marko, 2006
Studio
Piccolo, années 2000
Studio
Tempo original, Archives de Billy
Szawlowski
Console Neve au studio Tempo,
Archives de Billy Szawlowski
Billy
Szawlowski derrière la console
Neve
au studio Tempo,
Archives de Billy
Szawlowski
Billy
Szawlowski et Ian Terry lors d'un
enregistrement d'April Wine
Archives de Billy
Szawlowski
Studio
Marko
:
similitudes entre les studios Marko
et Victor conçus par RCA, 2006
Studio
Victor
: similitudes
entre
les studios Marko et Victor conçus par
RCA,
 Studio
Victor
avant son abandon temporaire
Studio
Victor
avant son abandon temporaire
Studio
Victor,
années 2000 circa
Opérateur chez RCA (gravure),
1948 circa
Collections
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ),
Fonds Conrad Poirier
Techniciens
chez
RCA (gravure), 1948
Collections
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ),
Fonds Conrad Poirier
Techniciens
à
la régie chez RCA, 1948
Collections
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ),
Fonds Conrad Poirier
Fabrication
des
disques chez RCA, 1948
Collections
de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ),
Fonds Conrad Poirier
Usine
de pressage chez London, 1966
Usine
de pressage chez London, 1966
Émile
Lépine
chez SNB, 1982
Émile
Lépine
chez London, 1982
Salle
de gravure chez London, 1982
*
Photographies des
collections de la
Phonothèque québécoise,
de
Bibliothèque et Archives
nationales du Québec,
des archives des studios
et des archives
personnelles des invités
|



